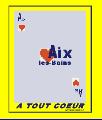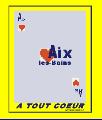Un couple de retraités, revenu en France après un séjour au Maroc, a cultivé quelques plans de cannabis dans une serre implantée dans leur jardin. Leur production dépassant leur consommation personnelle, ils ont cédé quelques plaques de résine de cannabis au fils de leur voisin.
Lequel a fait profiter quelques uns de ses amis étudiants de ce haschich naturel, moyennant quelques euros. A noter que les recettes de ces ventes couvraient à peine les frais d'électricité pour la production de la dite résine.
Suite à une dénonciation, le couple et leur jeune voisin ont été interpellés. Ils ont été présentés à un tribunal. En première instance, le couple et l'étudiant ont été condamnés à une peine de trois mois de prison avec sursis et à une amende de deux mille euros.
Le parquet a fait appel de cette décision trop légère à son goût. Un an plus tard la cour d'appel condamnait les trois prévenus à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec arrestation à l'audience, et à 7,5 millions d'euros d'amende.
D'aucuns ont alors crié au scandale et ont dénoncé la partialité des juges et la disproportion des sanctions.
Et pourtant, ces juges n'avaient fait qu'appliquer strictement la loi.
Confer l'article 222-34 du code pénal:
Le
fait d'organiser un groupement ayant pour objet la
production, la fabrication, le transport,
la détention, la cession ou l'emploi illicites
de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7
500 000 euros d'amende.
Comme quoi l'on peut faire dire ce que l'on veut quant aux décisions de justice.
Reste une question existentielle: qui juge les juges?
A méditer
Note à benêts: l'affaire évoquée ci-dessus n'est qu'une fiction, bien sûr.
Mais l'article du code pénal, lui, est bien réel. Quant à son application...